Aujourd’hui on fait un nouveau type d’article. Cela fait très longtemps que j’ai envie de vous partager quelques pages de mes carnets de recherche. J’y analyse très fréquemment l’image des films et leur portée narrative. Ce carnet est mon meilleur allié, j’y replonge régulièrement pour trouver des idées pour le boulot. Aujourd’hui, on va se pencher sur Miss Zombie de SABU. Du noir et blanc japonais sur fond de zombies ténébreux… de quoi bien s’éclater la cervelle.
N’oubliez pas de passer la souris sur les images pour y faire apparaître mes annotations.
« Miss Zombie », un film réalisé par SABU (Hiroyuki Tanaka), 2013. Grand prix du Festival international du film fantastique de Gérardmer 2014. Photographie : Daisuke Sôma Caractéristiques : Noir et blanc, ratio 2,35:1 Caméra et optiques : Red Epic, Zeiss Ultra Prime & Angenieux Optimo Durée : 85 minutes Synopsis : Teramoto découvre à sa porte une jeune femme effrayée, dans une cage, le corps couvert de bleus et de cicatrices. Elle s’appelle Sara et, devenue zombie, ne peut pas parler, ne se souvient de rien. Lorsque Teramoto l’engage comme domestique, elle subit l’opprobre et les humiliations répétées des habitants. Seules Shizuko, la femme de Teramoto, et Ken-Ichi la considèrent comme un être humain.
« Miss Zombie », thriller contemplatif et plastique
Le Japonais Hiroyuki Tanaka, a.k.a Sabu, est un habitué de polars et comédies rarement distribués en France. Ses films sont donc l’apanage de quelques cinéphiles sélectifs et pointilleux qui l’ont remarqué au travers de nombreuses de ses nominations dans des festivals internationaux prestigieux. Suivant assez peu l’actualité du cinéma de genre (je ne me nourris seulement de recommandations de mes proches éclairés), il y avait donc très peu de chances que mon chemin me mène vers Miss Zombie.
D’autant plus que les films de zombies… Ce n’est pas trop mon truc. Je trouve le thème usé, la réflexion bien souvent vieillotte. Puis disons-le franchement ; en pleine pandémie, je n’avais pas vraiment envie d’entendre parler de virus et de putréfaction. Puis, par hasard, je suis tombé nez à nez avec un photogramme du film. Et ce photogramme m’obsédait. C’est généralement bon signe chez moi. J’avais la sensation absolue qu’il y avait derrière lui, un trésor qui ne demande qu’à être contemplé. Le Grand Barbu peut témoigner de ma sainte horreur de qualifier un film de pépite, ou de chef d’œuvre. Mais finalement, tout en avalant les kilomètres sur mon rameur et maudissant la compression des plateforme de VOD, je me suis lancé.
Et je n’étais pas déçu…
Une “Miss Zombie” magnétique
Ceux qui détestent les films contemplatifs peuvent fuir. Difficile de trouver un film plus lent que Miss Zombie. C’est d’ailleurs ce qui permet d’en contempler deux ciments absolus et rigoureux : la direction d’acteur et la photographie. Peu de mouvements de caméras ou de changements de plans, mais des acteurs précis, justes, évoluant dans une esthétique aussi sublime que dérangeante.
Ma première intuition était plutôt bonne. Totalement à contrepied de ses précédentes productions, Sabu concentre la tension de son film dans une image magnétique. Une image qui attire, qui captive et capture, quasiment hypnotique. Ce n’est pas nouveau dans le cinéma nippon. Dans Ring de Hideo Nakata. Tout le génie du film résidait dans la mise en abîme de cette fascination mortelle pour l’image. Une pulsion scopique qui pousse de jeunes gens à “se faire peur” devant la télé. Et dont le sujet de curiosité, à force d’être regardé, finit par sortir du cadre auquel il devait être cantonné, attiré par tant de regards.
On retrouve quasiment la même pulsion scopique dans Miss Zombie. Une famille aisée achète une zombie faiblement contaminé. A la fois lubie orgueilleuse de nouveaux riches et prétexte à faire jaser les voisins, la nouvelle venue est l’objet de tous les regards. Celui horrifié de la population. Celui fasciné du petit Ken-Ichi et de son Polaroid. Celui fiévreux et pervers du personnel de maison… Et celle du spectateur avide. La palette est large et multiple. Mais personne ne peut s’empêcher de regarder la (très) lente torpeur de Sara.
Et la photographie contribue largement à cette capture hypnotique.
La radicalité d’un Noir et Blanc contrasté
La première chose que l’on remarque avec Miss Zombie ; ce sont bien évidemment ses contrastes poussés. Les noirs sont profonds, les blancs tranchés, quasiment brûlés. Cela donne une plastique brute, très graphique, incisive.
L’esthétique générale du film rappelle une des signatures contemporaines de la photographie nippone. On la retrouve chez Araki, ou plus récemment chez Tatsuo Suzuki. On le constate aussi en occident dans toute l’œuvre de Helmut Newton. Mais la pratique se fait de plus en plus rare dans le plein règne de l’image en Ultra Haute définition.
Dans l’imagerie contemporaine, les noirs profonds sont très discrets. Ils glissent très vite dans des dégradés de gris pour “conserver les détails“. Et bien souvent cette obsession technique me dérange. Comme si la perte d’information numérique dans les ombres trahissait l’amateurisme. Refuser le détail, ce n’est pas refuser la finesse ! Et le réalisme n’est pas un gage d’émotions… bien au contraire.
Il y a une très belle conversation entre Jean Renoir et Jacques Rivette à propos de cette obsession pour le détail et le progrès techniques dans les arts. Renoir y évoque la tapisserie de la reine Mathilde à Bayeux. Les laines épaisses et colorants limités utilisés à l’époque sont bien loin des fils de soies et multiples teintes des tapisseries voulues par la suite par Henri IV. Mais ces nouvelles tapisseries, toujours plus fines et détaillées, n’égalent jamais le sublime de la tapisserie de Bayeux. Pire, à être trop réalistes, elles signent le désintérêt et le déclin de la pratique.
A l’heure de l’intégration du 8K, du RAW, du 12 bit dans nos machines, n’est-il pas tant de se questionner sur le but réel de ces innovations ? Sommes-nous condamnés à sans cesse tout montrer afin de ne pas être taxés d’amateurs ? Un film n’a pas vocation à être une démonstration technique. Miss Zombie est là pour prouver le contraire, en assumant une direction radicalement opposée… mais maîtrisée à la perfection. Et avec un souci maniaque du détail.
De la lumière et des ténèbres
Daisuke Sôma n’est pas particulièrement connu pour une photographie savante. Mais pour Miss Zombie, il est difficile de ne pas être stupéfait par l’érudition de bons nombres de plans. On pourrait voir dans ce noir et blanc une simple coquetterie de chef op. Mais plus on s’y penche, et plus le travail plastique est évident et conséquent.
Pour rappel, la philosophie picturale japonaise, à l’inverse de l’occidentale, porte un regard très pointu sur les ombres. D’ailleurs, je vous conseille la lecture de l’excellente “Éloge de l’Ombre” de Jun’ichirō Tanizaki. C’est un regard de référence sur la manière d’envisager et sublimer l’ombre dans le quotidien et les arts picturaux.
(Pro Tip : pour les jeunes parents, ça aide à accompagner vos enfants dans leur peur du noir).
Cette articulation autour de l’ombre et de la lumière est pleinement assumée dans Miss Zombie. L’univers de Sara dépasse rarement le quart de l’amplitude d’exposition, le plongeant ainsi dans des noirs profonds (mais non moins fins). Le quotidien de la famille Teramoto est, quant à lui, baigné de lumière solaire.
Ce contraste poussé oppose donc deux entités radicalement différentes. Sara appartient, en tant que zombie, au monde des ténèbres. Et sa psyché est tout aussi impénétrable que les ténèbres qui l’entourent. De l’autre côté, la famille Teramoto agence tout son univers pour être vu, lisible et socialement efficace.
De la nature et de la mort.
C’est donc sur cette dichotomie contrastée que va se construire tout le film. Par extension, elle s’inscrit dans une franche opposition entre naturel et artificiel, mort et vivant. La biologie seule peut-elle définir le vivant ? La putréfaction n’est-elle d’ailleurs pas plutôt une continuité plutôt qu’une fin ? Ces interrogations philosophiques sont très régulièrement soulevées au Japon, où sciences et techniques cohabitent au quotidien avec la philosophie et la spiritualité. Et elles hantent le film avec finesse.
Pour mettre en image cette confrontation, le contraste de luminance ne suffit pas. Miss Zombie va appuyer le contraste sous toutes ses formes. Les premiers plans du film s’ouvrent avec Sara, visuellement emprisonnée par les lourds barreaux de sa cage. Et cet emprisonnement se répète tout au long de son évolution dans le film. Son cagibi n’offre aucune ligne de fuite. Les ombres qui l’habitent sont tout autant de barreaux verticaux qui l’enferment dans une nature qui n’est pas la sienne.
Mais si Sara est de facto la prisonnière, ses propriétaires n’en sont pas moins enfermés. Quotidien moral, statut social, convenances… la liste d’interprétations est possiblement longue. Difficile d’ignorer la surabondance de lignes franches, bien souvent verticales, qui peuplent le quotidien de notre famille modèle. Quand on connait la rigueur du modèle familial japonais, l’évocation semble même évidente.
Le vice est poussé jusqu’à couper la famille de toute évocation du naturel. Les fenêtres sont fumées, les ouvertures obstruées. Tout ce qui peut agir comme un échappatoire est sans cesse bouché par une artificialité qui ferait paniquer n’importe quel claustrophobe.
Cette artificialité est matérialisée par ces lignes franches qui créent toujours plus de cadres et de limites dans l’image. Elles enferment régulièrement tout ce qui a attrait à la vie et au naturel. A l’inverse, toutes les courbes ou aspérités appartiennent au registre du vivant, de l’aléatoire, de la mouvance.
De la vie et du désir.
Or, c’est le visage de Sara, en décomposition, qui illustre ce mouvement. Il est le point central de l’esthétique du film. Fugace, invisible une bonne partie du film, il n’est accessible que par une peau très blanche qui n’est pas sans rappeler celle des Geisha. Propriétés d’hommes puissants, objets tantôt cachés, tantôt montrés, le parallèle est éloquent. Car cette Miss Zombie devient elle-même objet de désir et de fantasmes, apparaissant avec plus ou moins de clarté en fonction des plans.
Tout comme les geishas, elle fascine les hommes tout autant qu’elle les inquiète. Cette impassibilité de façade et de servitude sait trahir la passion et l’humanité d’un seul regard. C’est donc dans le visage des personnages, émergeant régulièrement de l’ombre au mépris de la cohérence physique, que l’on cherchera désespérément quelques indices d’humanité.
De la vérité et de l’artificiel.
Seul Ken-Ichi armé de son polaroid et de la lucidité de l’enfance semble détenir la vérité. Au point de devenir le point pivot du film (je vous laisse découvrir). Cette vérité est quasi-métaphysique. Elle est la réponse à la question “qu’est ce que l’humanité ?”. Une sorte de quête spirituelle constamment nichée dans les blancs de l’image.
Ceux ci sont régulièrement aussi “brûlés” que “brûlants”. Cette sur-exposition apparente rappelle à la fois la brûlure du soleil sur le corps maudit de Sara et celle du flash du polaroid qui s’acharne à capturer la vérité. Elle évoque la brutalité de la vérité, la violence de la mise en lumière. Mais cette clarté reste pour autant vaporeuse, insaisissable (là où, rappelez-vous, tout est parfaitement lisible dans nos lignes franches artificielles). C’est une vérité nébuleuse, spirituelle, à la fois onirique, attirante, que mystique et potentiellement bouleversante.
Ces contrastes mettent en valeur l’équilibre délicat entre le naturel et l’artificiel. Qui du zombie ou de son propriétaire incarne le monstre et l’humain ? La lente torpeur de Miss Zombie contribue à installer une tension aussi hypnotique que diabolique. On guette avidement le moindre indice qui permettrait de répondre enfin à la question.
Parfois la suggestion visuelle d’un moment pivot apparaît dans un coin de l’image. Capricieux ou sadique, le temps se dilate alors encore plus, renforçant la dangerosité potentielle d’un basculement de l’ordre établi. Et de donner ainsi toute sa puissance plastique à des éclairs de lucidité aussi.
De la texture et du mouvement.
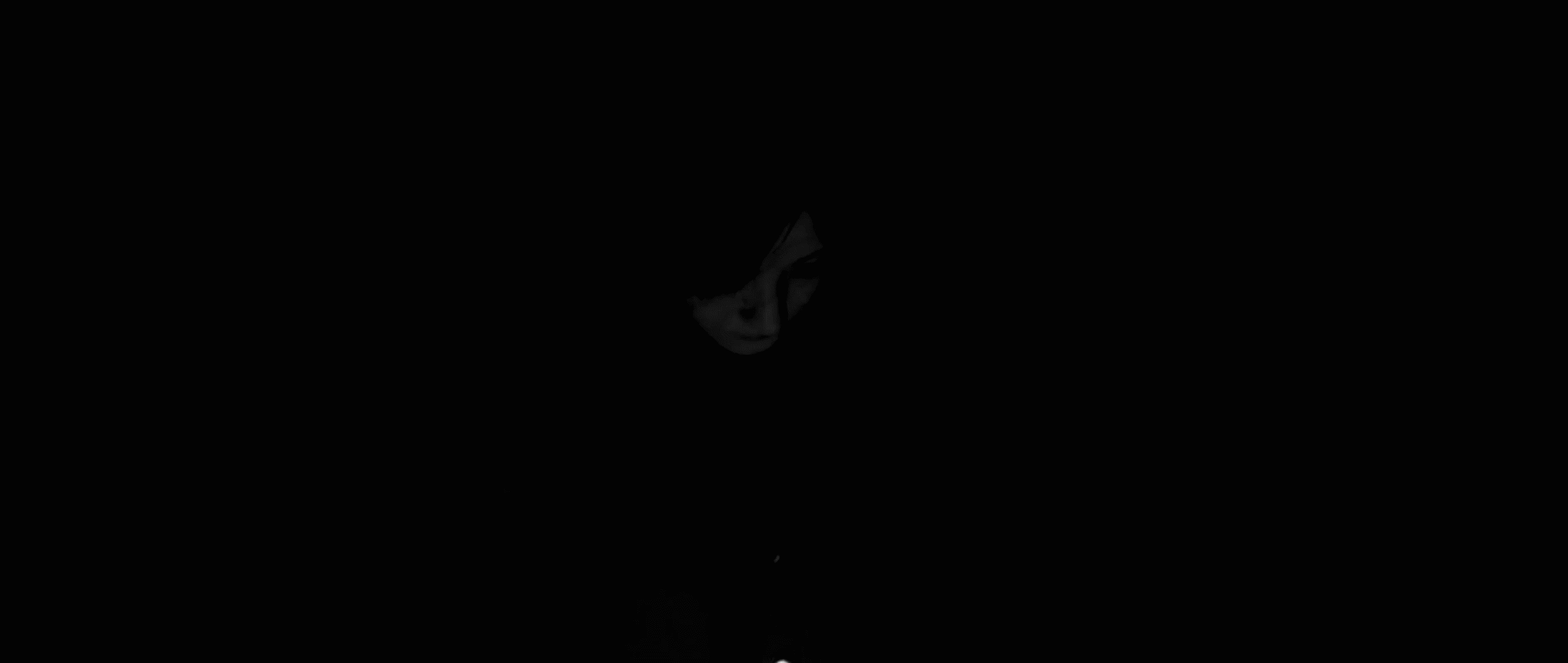
Si ce noir et blanc millimétré n’est qu’une coquetterie de chef-op. Alors Daisuke Sôma est un immense génie qui s’ignore. Car en plus de ces contrastes s’ajoute une maîtrise particulière du mouvement. C’est un des points forts du cinéma (et des arts) japonais. Chaque élément possède un mouvement inné qui invite le regard à un autre mouvement. Cette notion est redoutable en cadrage et en composition… Et quand elle est parfaitement maîtrisée comme ici, en montage.
Le mouvement donne à la fois une texture et donc un caractère ; c’est ce que l’on appelle le momentum. Il suffit de s’imaginer regarder un drap de satin et un bout de papier de verre pour comprendre que même inanimées, les textures sont suggestives et créent un propos, lui-même mouvement. La vision d’une peau blanche crée un magnétisme érotique. Le sang visqueux crée un sentiment de répulsion et de malaise.
Tout texture crée donc un mouvement. Dans Miss Zombie, les noirs profonds sont à la fois des rideaux opaques et des brèches obscures. Comprendre que tout peut sortir de ces barrières de ténèbres impénétrables. La violence, la pulsion, et ce avec une colère violente, précise, incisive.
Du mouvement de texture au mouvement narratif.
Mais le génie de Daisuke Sôma est de convoquer plusieurs niveaux de mouvements et les combiner avec une belle justesse. Nous venons de voir que la texture d’une peau putréfiée crée déjà un mouvement. Que se passe-il quand une peau putréfiée se met elle-même en mouvement ? Et que se passe-t-il quand cette peau mouvante est filmée par une caméra en mouvement ? (Oui hein ? C’est le moment de se sortir une aspirine.)
La mise en scène de Sabu est déjà assez pointilleuse sur le mouvement des acteurs et des caméras. Chaque personnage possède sa propre manière de marcher. Chaque mouvement de caméra suggère un premier propos. Mais Daisuke Sôma y rajoute une nouvelle dimension en utilisant le mouvement aussi comme un élément plastique. Par exemple, dans la scène ci-dessus on voit comment les ténèbres sont à la fois outils de montage et vecteur de violence. Ils se superposent à l’action, à la fois comme esthétique et rupture avec le récit, décuplant efficacement sa réception.
En outre, comme si ça ne suffisait pas, plus on avance dans le film, plus le mouvement devient composition. Ce retour à la nature, ce retour à l’humanité, ce retour à la liberté s’illustre d’un retour à un contraste plus doux où tout est foisonnant. Le chef opérateur combine la vitesse d’obturation, les herbes hautes et le mouvement rapide de la caméra à une profondeur de champ à l’infini. Cela a pour effet, de créer un ersatz de Split Diopter (et/ou de Tilti Shift) redoutable où les herbes deviennent floues et seuls le mont Fuji et les personnages sont nets. Comme d’habitude dans Miss Zombie, seuls les points clefs sont parfaitement lisibles. Ce par l’exploitation simple du flou de mouvement. Qui se nourrit lui-même.
Le Mont Fuji est la première évocation d’un extérieur possible. Il est blanc, net et dans la continuité des personnages (à gauche du cadre et dans leur ligne de force). Mais il est aussi dans un mouvement contraire ascendant, là où les personnages ont une course descendante. Cela contribue à semer le doute, et créer de la tension sur l’issue de cette course poursuite.
Miss Zombie est une expérimentation filmique.

Miss Zombie est – à bien des égards – un OVNI cinématographique à voir. Il s’apparente d’avantage à une expérimentation qu’à un film de public. Et c’est ce qui m’a interpellé. Passée la barrière de l’ultra-contemplatif, on se laisse embarquer par cet équilibre à la fois délicat et malsain. Et tout dedans est d’une précision qui ne laisse pas d’échappatoire. Bien sûr il appartient à chacun d’avoir sa propre réception de ce travail. Je ne crois pas que le film convienne à une grande majorité de spectateurs. Peut-être donc que ces annotations vous aideront à l’apprécier autant que moi, je l’ai apprécié.
Faire une analyse plastique et technique est toujours un pari. En cours, soit mes étudiants adorent, soit ils trouvent que c’est de la belle branle**e (Généralement je les menace assez pour qu’ils adorent). C’est surtout une excellente manière de s’inspirer, de travailler son style et de trouver des idées d’inspirations. Depuis que je tiens ces carnets, ma pratique s’enrichit d’une manière que je n’aurais jamais imaginée il y a 10 ans. Je me surprends même à retrouver dans certains de mes travaux, des réinvestissements que j’ai du faire malgré moi.
Cette approche plastique du cinéma peut paraître étrange. Mais c’est comme ça que je vis le cinéma : comme un objet que l’on a envie de toucher, ou de fuir. Mon côté geek des premiers jours s’est effacé face à l’exigence du rendu. Face aux obsessions de l’expérimentation. Je fais partie de ces vieux cons qui trouvent qu’un film sur toile n’a pas la même présence qu’un film sur écran. Et ça prend un temps fou qui se marie mal parfois (souvent) avec les exigences de production.
Mais si vous avez aimé ce format d’article. Laissez un commentaire en dessous et faites le tourner sur les réseaux en me taguant. Ça me fera vraiment plaisir !
N’hésitez pas non plus à me laisser en commentaire le nom d’un film dont l’image vous a interpellé.
Je suis toujours à la recherche d’inspiration. Et qui sait ? J’en ferais peut-être un article .








